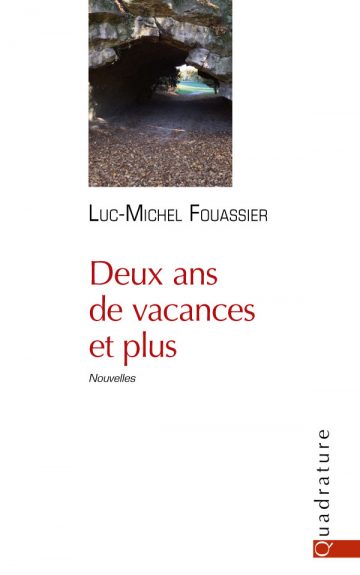Qu’il s’agisse de participer à une course d’endurance, de mettre le point final à un roman, de retrouver les héros de son enfance, de parvenir au terme d’un repas affligeant, de refaire le voyage de noces de ses parents, de séduire Isabelle Adjani ou d’accompagner son meilleur ami au cimetière, la tâche s’avère à chaque fois difficile. Pourtant, les personnages de ces sept nouvelles sont décidés. Ils iront jusqu’au bout.
- ISBN 97829305386 (format broché)
- ISBN 9782930538617 (format ePUB)
- 102 pages
- Livre broché - 15€
- ebook - 9.99€
Extrait
L’accompagnateur
À mon père et ses dix heures quarante-deux minutes et dix-sept secondes
Je n’avais jamais vraiment regardé les jambes de mon père. Ce n’était pourtant pas la première occasion qu’il m’était donné de le faire. Nous avions passé tant de journées de vacances sur la plage de Royan, vêtus seulement de maillots de bain, mes parents, mes frères et moi. Mais à cette époque – peut-être la plus heureuse de mon enfance –, je n’étais encore qu’un gamin et mes préoccupations se limitaient à l’édification de châteaux de sable, au passage régulier des vendeurs de chichis ou au gonflage laborieux de mon canot pneumatique.
Au milieu de la foule, à l’instant du départ, mes yeux ne pouvaient se détacher de ses jambes. Je me suis surpris à les trouver belles, les mollets dépourvus de toute pilosité (certainement le frottement régulier du survêtement, l’hiver), les muscles bien dessinés. Les cuisses, pour un homme de plus de soixante ans, n’affichaient pas la maigreur flasque qu’on retrouve habituellement chez les personnes du même âge. J’ai ressenti une certaine fierté. Mon père n’était pas pourri, pour reprendre une expression qu’il employait souvent du temps où j’habitais encore à la maison.
La musique qui, jusque-là, beuglait dans les haut-parleurs s’est tue brusquement. Une rumeur a parcouru la foule des coureurs amassés entre les barrières métalliques disposées de part et d’autre de la chaussée. J’ai regardé ma montre. Dix heures moins cinq. Le départ allait bientôt être donné. La plupart des coureurs commençaient à sautiller sur place. On lisait une grande fébrilité dans les regards. Ce n’était pas seulement une compétition sportive qu’on allait disputer, on était conscient qu’on prenait part à une véritable aventure, digne des héros de la mythologie, supérieure par l’effort au fameux exploit du messager Phidippidès. Cent kilomètres ! Les cent kilomètres de Millau. Plus du double d’un marathon ! Je ne pouvais m’empêcher de penser que tous ces types autour de moi étaient complètement cinglés.
Malgré l’heure matinale, l’air chargé d’odeur d’embrocation était déjà étouffant. L’été résistait et ne semblait pas disposé à nous quitter. J’ai pris le bidon accroché au cadre de mon vélo et j’ai bu une gorgée d’eau. Elle avait un arrière-gout de plastique. Il aurait fallu le rincer davantage après l’avoir acheté. Un sentiment d’angoisse m’a étreint tout à coup. M’étais-je assez préparé ? J’ai regardé les autres accompagnateurs tout autour, ceux qui, comme moi, avaient préféré se tenir près du départ au lieu de se poster en aval pour attendre leur coureur respectif. Ils avaient tous un équipement des plus pensé. Des pochettes bourrées d’aliments énergisants arrimées un peu partout sur le cadre du vélo, souvent une trousse à pharmacie ficelée au porte-bagage. Certains avaient même installé de petits postes de radio sur leur guidon en prévision des longues heures d’ennui. L’équipe de France jouait, en fin d’après-midi, un match capital du championnat d’Europe de football, ils n’en perdraient pas une miette.
Mon vieux biclou ne possédait même pas de garde-boue. Je l’avais emprunté à un ami qui l’avait, lui-même, hérité de son grand-père. Le peu d’affaires que j’emportais – deux bidons, quelques barres de céréales, un K-Way – tenait dans mon sac à dos. C’était plutôt raccord avec ma vie qui, ces derniers temps, se résumait à pas grand-chose. Tiendrais-je le coup, serais-je à la hauteur de ce que mon père attendait de moi ? Je n’ai pas eu le temps de me poser plus de questions. Le coup de feu du starter a retenti et, dans un rythme soutenu qui m’a surpris pour le départ d’une course de grand fond, les concurrents se sont élancés sur l’avenue pour traverser la ville et prendre la direction de Le Rozier. Les quelques coureurs formant l’avant-garde du peloton pourraient se réjouir d’avoir mené, durant quelques minutes, les mythiques 100 bornes de Millau.
J’ai regretté de n’avoir pu croiser une dernière fois le regard serein de mon père, celui d’avant l’effort.
En moins d’un quart d’heure, je l’ai rejoint, remontant la théorie des coureurs. Avec la multitude – ils étaient plusieurs milliers à avoir pris le départ –, j’aurais été bien incapable de dire si mon père se trouvait en bonne place. Combien en avait-il derrière lui ? Et devant ? Il m’avait fallu en doubler un paquet pour venir me positionner, comme tout bon accompagnateur, juste derrière lui. Mais était-ce vraiment là l’essentiel ? La veille, alors que nous dinions à l’hôtel, mon père n’avait cessé de me répéter que le plus important, c’était de terminer ces foutues cent bornes et que, les places d’honneur, il n’en avait rien à faire. J’avais dû avoir une expression sur mon visage lui signifiant que tout le monde ne partageait pas cette vision de la compétition car il avait cru bon d’ajouter qu’il était passé dans la catégorie Vétéran III. Un sentiment d’amertume m’avait alors envahi que j’avais cherché à dissiper en m’envoyant une bonne gorgée de Corbières. Dans la boite qui venait de me virer, c’étaient encore les vétérans qui menaient la danse et prenaient les décisions…
– Ça va ?
– Faut trouver le rythme.